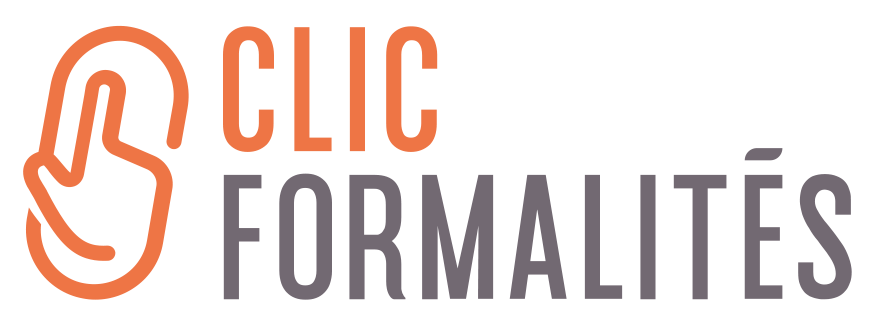Catégorie : Guide de l’Entrepreneur
-

Bien assurer son prêt professionnel
Tout professionnel, qu’il soit entrepreneur, auto-entrepreneur ou exerçant en profession libérale, a la possibilité de contracter un prêt professionnel pour réaliser un projet immobilier, acheter un fonds de commerce ou tout simplement investir dans le cadre de son activité. Comme pour un crédit personnel, bien que non obligatoire, il est quasi impératif d’assurer son prêt.…
-

Zoom sur les business angels
Si la création d’entreprise peut s’apparenter au départ à un conte de fée, elle peut vite tourner au cauchemar si le porteur de projet ne trouve pas les financements indispensables au commencement de son activité. Heureusement comme tout conte qui se respecte, il y a toujours une aide providentielle qui apparaît : un business angel.…
-

Apports en nature : les nouveautés 2017, tout ce qu’il faut savoir
La création d’entreprise est une alchimie reposant sur la rencontre de plusieurs éléments : une idée à l’origine du projet, une ou plusieurs personnes désireuses de la mener à bien. A cela doit également s’ajouter des biens mis en commun pour concrétiser cette volonté d’entreprendre. Les futurs associés de l’entreprise, s’ils ont pour ambition de…
-

Jeune Entreprise Innovante (JEI) : son statut et ses avantages
Entreprendre, c’est avant tout innover. L’Etat a mis en place au cours des dernières années, un arsenal pour faciliter la création d’entreprise et l’innovation. Ces politiques publiques ont pour objectif de favoriser l’emploi et d’inciter tous les porteurs de création d’entreprise. Du chômeur au chercheur, chacun a la possibilité de réaliser le rêve de créer…
-

Start-up Nation : Macron en Marche Numérique !
Emmanuel Macron veut favoriser le développement des « Jeunes pousses ». Non, le Président ne se lance pas dans l’agriculture et ne compte pas faire de la France un potager géant. Ce terme désigne les start-up : des jeunes entreprises innovantes et dynamiques qui propulsent le secteur des nouvelles technologies. La France sera le pays «…
-

Les apports en nature, en numéraire et en industrie
“Créer son entreprise pour devenir riche ou être riche pour créer son entreprise ?” Si l’argent reste bien souvent l’un des nerfs de la guerre, sa place a été considérablement réduite pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Les règles sur le montant du capital minimum se sont assouplies.Le seuil de 7500 € a été…
-

RSI en sursis ? Les enjeux 2018
Le Régime Social des Indépendants (RSI) fait énormément parler de lui ces derniers temps. Le régime se voulait être un régime simplifié pour les Travailleurs Non Salariés : Auto-entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales. Créé en 2006, le RSI représente aujourd’hui : 6,6 millions de chefs d’entreprises indépendants actifs, retraités et leurs ayants droit 4,6…
-

Déclaration de revenus 2018-2019 : Le prélèvement à la source et autres obligations
« Trop d’impôt tue l’impôt » ? C’est en tout cas ce qu’affirmait l’économiste libéral Arthur Laffer au moyen de sa courbe mathématique éponyme. Les réductions d’impôts et la politique de l’emploi ont été au cœur des débats de l’élection du président Macron. Au préalable, une réforme fiscale sur le prélèvement de l’Impôt à la…
-

Impôt sur les Sociétés : Ce qu’il faut savoir pour 2017 et 2018
« Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît ». Cet adage séculaire ne peut s’appliquer pleinement aux chefs d’entreprise… Comme tout bon contribuable, il doit établir sa déclaration relative à l’Impôt sur les Sociétés. Rien de tel alors qu’un calendrier fiscal pour repérer les échéances clés. L’actualité est aussi à suivre de très près avec…
-

Une journée au tribunal de commerce avec un entrepreneur en liquidation judiciaire
Depuis janvier 2017, près de 90 000 entreprises ont été radiées du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Ces entreprises ne peuvent plus faire face aux dettes exigibles avec l’actif disponible. Si elles sont en cessation des paiements et que le redressement judiciaire s’avère manifestement impossible. Une procédure en liquidation judiciaire est alors enclenchée…